Evolution
de la flotte de guerre française (1669-1772)
A
partir des données extraites des états abrégés,
il y aurait matière à faire quantité de
statistiques dimensionnelles, géographique ou économiques.
Nous nous contenterons d'étudier l'évolution du
nombre des bâtiments, canons et tonnage global de la flotte,
ainsi que la répartition par ports.
Bâtiments,
canons et tonnage global
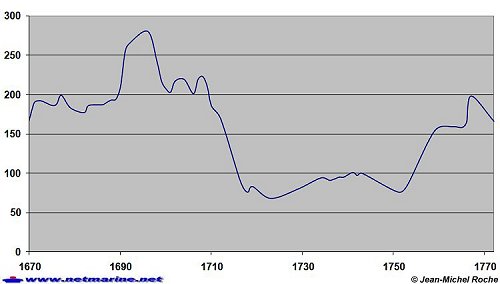 |
| Nombre
de bâtiments de la flotte française. |
S'il
était encore nécessaire pour s'en persuader, les
trois courbes présentées démontrent que les
années du règne de Louis XIV (1661-1715), et particulièrement
celles du ministère de Colbert
(1669-1683), marquent l'apparition pour l'Etat français
d'une flotte de guerre sans précédent dans
l'histoire.
Colbert,
qui crée les arsenaux de Brest, Toulon et Rochefort,
passe commande de plusieurs centaines de bâtiments. Son
oeuvre sera poursuivie par son fils le marquis de Seignelay
de 1683 à 1690, puis Louis Phélypeaux comte de Maurepas
jusqu'en 1699. En 1696, la marine française compte 280
bâtiments de guerre.
La
paix de Ryswick (1698) vient ralentir considérablement
cet effort. Dès le début du XVIIIe siècle,
alors que les finances du royaume sont au plus bas, les vaisseaux
pourrissent à quai et le rythme des constructions
navales s'effondre.
Une
marine de guerre se construit dans la durée
La
Régence (1715-1723), liée à
une crise des finances publiques et l'instabilité en
politique intérieure, marqua un désintérêt
à peu près complet pour la marine de guerre. Le
point bas est atteint en 1723 avec 68 bâtiments.
La
France n'est plus maîtresse de ses routes commerciales
sur mer. Les
compétences en matière de construction navale
se font rares, ce qui explique en partie la lenteur du redémarrage
que l'on constate à partir de 1750.
Sous
l'impulsion, non pas - comme il est souvent à tort affirmé
- de Jean Frédéric Phélypeaux de Maurepas
(secrétaire d'Etat à la marine de 1718 à
1749), mais de ses successeurs, en particulier Étienne-François
duc de Choiseul, on assiste à une renaissance
de la flotte à partir de 1750. Mais une
marine de guerre se construit dans la durée,
et il faudra 20 ans, pour qu'un résultat
tangible apparaisse : ce fut notamment les
batailles victorieuses de la guerre d'Amérique, en soutien
aux insurgés américains.
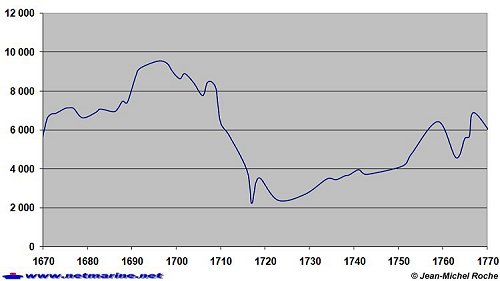 |
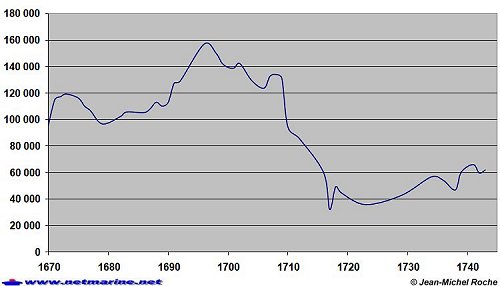 |
| Nombre
de canons |
Tonnage
global |
Répartition
par ports
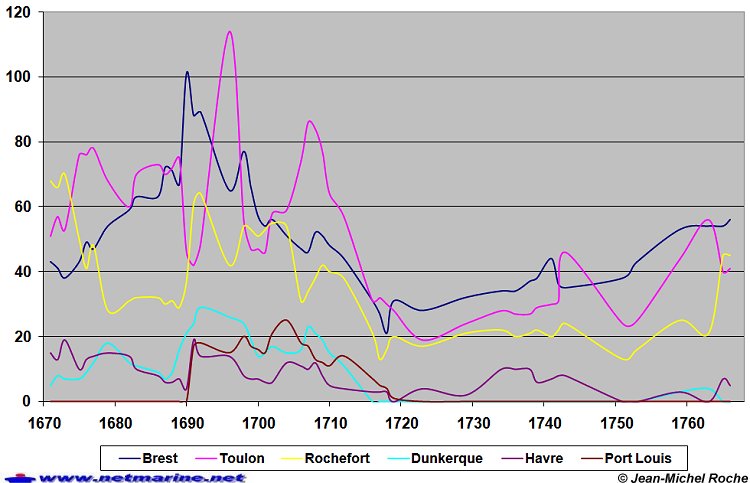 |
| Répartition
des bâtiments par ports bases |
Les
ports de Toulon et Brest sont
sans conteste, pendant cette période, les plus importantes
places fortes maritimes du royaume. Leur suprématie se
confirmera au fil du temps.
Dès
1666, Toulon est désigné pour
devenir le grand port de guerre du Levant. L'impulsion donnée
par Colbert,
se voit dans le nombre de bâtiments affectés, et
qui culmine par 114 bâtiments en 1696,
un pic consécutif au « grand armement de Toulon »
en 1693.
Au
Ponant, le développement de la ville de Brest,
dont la population passe de 2 000 habitants en 1661 à
9 000 en 1690, est le reflet de l'essor de l'arsenal qui
voit stationner jusqu'à 101 bâtiments de guerre
en 1690.
Il
ne faut cependant pas négliger Rochefort,
dont l'arsenal, créé en 1666, se développe
rapidement, puis souffre de la concurrence de Brest dont l'essor
(1670-90) marque une période de relatif déclin
pour Rochefort (moyenne de 30 bâtiments stationnaires).
Mais c'est surtout la situation géographique de Rochefort
qui lui sera préjudiciable. Sur la Charente à
20 kilomètres de la mer, cette position qui garantit
une protection contre les attaques anglaises, va se révèler
un lourd handicap pour la navigation, de part la faible profondeur
du fleuve.
Les
ports de Dunkerque, Le Havre
et Port Louis resteront, tout au long de cette
période, des places d'importance secondaire.
En effet, pour la façade Manche et mer du Nord, la menace
anglaise étant jugulée plus par l'action des corsaires
de Saint Malo et Dunkerque que par la mise en place de bâtiments
d'Etat stationnaires. Quand à Port Louis
(Lorient), s'il est un port de construction important, son arsenal
restera trop fortement concurrencé par Brest et Rochefort
pour en faire un port militaire majeur.
Net-Marine © 2011. Copie et usage : cf. droits
d'utilisation. Pour
en savoir plus : Dictionnaire
des bâtiments de la flotte de guerre
de Colbert à nos jours.